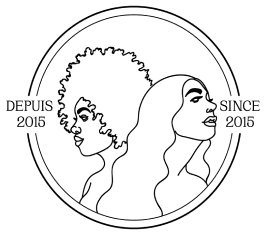By Fatima Terhini
Jeanne-Marie Rugira est professeure au département de psychosociologie et de travail social à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Elle est directrice des programmes de premier cycle en psychosociologie. Elle est aussi consultante et accompagnatrice d’organismes sur les questions d’inclusivité, de racisme et de féminisme intersectionnel.

Cette femme au parcours inspirant est arrivée au Québec au début des années 1990 pour faire ses études doctorales. Quelques mois après son arrivée, alors que son pays est à feu et à sang, elle sera contrainte de demeurer sur le sol québécois en tant que réfugiée et entame, par la suite, un parcours semé d’embûche. À travers ses expériences académiques et terrains, Jeanne-Marie navigue avec une lucidité déconcertante entre ces différents obstacles. Dans cette entrevue, elle nous livre comment la transformation vers des organisations plus inclusives s’opère à travers son travail. Sa voix m’a conté maintes leçons de sagesse, et cette brève entrevue, ne représente qu’un soupçon de ces dernières. En espérant que ces mots, véritables invitations à la transformation sociale dans la lutte antiraciste, vous apprendront tout autant qu’à moi.
F : Comment as-tu commencé ton travail de consultante auprès d’organismes sur les questions reliées aux diversités ?
J.M : Je dirais qu’en 2016, quand j’ai eu la citoyenneté canadienne, j’ai repris ma parole citoyenne. Quelque chose s’est ouvert et ça m’a donné l’autorisation d’avoir une parole. J’ai repris mon militantisme féministe, j’ai repris mon militantisme antiraciste. C’est ça, tout à coup j’étais chez moi. J’avais mon mot à dire. Je me disais que je devais à ma terre d’accueil d’œuvrer avec les autres pour continuer de bâtir une société plus juste. […] Je me suis impliquée dans mon milieu, et depuis je travaille auprès des organisations avec qui je partage les valeurs et les préoccupations, rendre les services plus accessibles, plus équitables et plus inclusives, surtout pour les populations historiquement marginalisées. Ce travail est donc cohérent avec mes valeurs, avec mon histoire. Et, aussi cohérent avec mon regard singulier qui ajoute une voix à celles qu’on est habitué d’entendre.
F : Tu travailles dans des organismes à vocation de justice sociale, qui sont féministes, mais qui viennent te voir afin d’avoir des pratiques plus inclusives. J’imagine que ce sont des organismes majoritairement composés de personnes blanches ?
J.M : Oui.
F : Dès lors, comment tu t’assures d’implanter ces stratégies ? Quelles sont les bonnes pratiques afin de travailler dans ce contexte ?
J.M : La première chose que je fais, c’est de travailler sur la question du lien. La construction du capital relationnel et de la reconnaissance de notre commune humanité. On essaie de bâtir des conditions pour se rencontrer, se fixer une cible commune qui transcende nos différences et ainsi ne pas laisser les habitudes institutionnelles nous empêcher de nous rencontrer. La deuxième chose sur laquelle je travaille beaucoup, c’est la reconnaissance des privilèges et la responsabilité qui vient avec ces privilèges […] Je donne aussi des formations sur l’intersectionnalité, sur les biais inconscients. Dans ces formations, nous travaillons chacune sur nos biais. Pas pour ne plus jamais en avoir, mais pour être certaines qu’on en a et donc d’y faire attention. Ce n’est pas à moi de leur dire comment faire, mais, plutôt à elle de faire en sorte que leur biais inconscient ne deviennent pas des obstacles à l’inclusivité. Finalement, que ces biais n’empêchent pas d’accompagner convenablement, des personnes qui ne leur ressemblent pas.
F : Quels sont les défis au dialogue ?
J.M : Premièrement, je travaille avec des cercles de parole, pas avec des débats, et je fais en sorte de ne pas travailler à partir des débats. Aussi, je ne veux pas que l’on se parle d’idées, mais plutôt d’expériences. Parce qu’avec les expériences, on peut se rencontrer comme humain. e. s. […] Si l’on se demande, par exemple, « à quel moment ai-je vécu.e l’oppression ? » que tu sois blanc, noir, sourd, LGBTQI+ tu as vécu l’oppression. Mettons, tu peux être une femme blanche, mais t’as au moins vécue de l’oppression par rapport à ton genre, ta classe sociale, ton poids…qu’en-sais-je. Alors, j’aime mieux, plutôt que d’aller sur les identités, opinions ou idéologiques revenir sur l’expérience humaine et regarder en quoi mon expérience d’oppression peut me permettre de te comprendre. Puis, que là-dedans, même si on a pas la même couleur de peau, pas les mêmes yeux, tu redeviens ma sœur en humanité. Mais, pour ça, il faut avoir du temps et aussi des méthodes de travail quoi.
F : Justement, après la construction du lien, quelles sont les méthodes de travail que tu mets en place ?
J.M : Après s’être rencontré.e.s, on peut avoir une mission, une vision commune. À partir du moment de la rencontre, là on se dit okay, comment moi X ou Y je veux vivre dans une organisation non oppressive. Du coup, on fait des politiques qui viennent de ces endroits-là où on ne souhaite pas faire revivre aux autres ce que l’on a subi. Là, on questionne de manière critique nos pratiques et nos politiques. Mais ça se fait petit à petit, nous sommes entre humain.e.s, cela ne se fait pas d’un coup. Mais, en même temps, ça devient beaucoup plus intéressant.
F : Un mot de la fin en tant qu’intervenante psychosociale et consultante spécialisée sur les questions d’inclusion et diversité à nos lecteurs.rices ?
J.M : J’aimerais dire aux jeunes femmes de la diaspora africaine de s’intéresser aux autres, arrêtons de nous essentialiser nous même en nous identifiant surtout à l’oppression vécue. Intéressons-nous aux autres, aux Québécois, à ce qu’ils vivent. Un Québécois n’est pas un Français, un Français n’est pas un Allemand et un Allemand n’est pas un Belge. L’identité blanche mur à mur n’existe pas. Ce n’est qu’un construit social, variable et évolutif, selon les personnes, les contextes, les époques, etc. Et ce que la vie m’a appris, c’est que quand je m’intéresse aux autres, ils finissent par s’intéresser à moi […] Tu sais, quand je suis arrivée ici, la première chose dont je me suis rendu compte c’est que je parlais français, mais que je ne comprenais pas l’humour québécois. Ils ne me faisaient pas rire, et cela même si je comprenais leur langue. Alors tu sais, je me suis mise à décortiquer leur imaginaire. J’ai alors commencé à regarder les feuilletons québécois, je lisais le soleil, le devoir. Je regardais les débats en chambre, je lisais les romans québécois […] J’ai fait ce pas là de m’en aller vers eux parce que je n’avais pas le choix, parce que je ne pouvais pas aller dans un ghetto. Finalement, c’est la chance que j’ai eue d’immigrer en région. Parce que des fois, le confort de nos ghettos c’est ce qui nous empêche de comprendre leur codes. […] Après avoir compris, tu es libre de prendre ou non ces codes. Tu peux redevenir toi et choisir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Mais, au moins, tu comprends les choix que tu fais et tu peux les expliquer. Du coup, tu peux influencer la culture et te laisser toi aussi être bonifiée par la rencontre de l’autre. On peut influencer la culture quand on la comprend pour, finalement, arriver à ne pas nous-mêmes nous essentialiser. Je trouve que c’est quelque chose d’important.

Fatima Terhini
Writer
Fatima Terhini describes herself as an "artivist" primarily concerned with feminist, anti-racist and decolonial issues.Her degree in psychosociology and experience in community work attest to her insatiable curiosity and love for humans, living beings and, of course, social facts. She joined Sayaspora in October 2020 as a community manager, but her love of writing and reading steered her a year later towards the blog, where she holds the position of co-editor-in-chief.