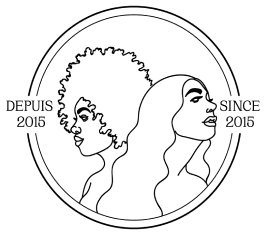5 mai 2017

Par Kathleen Nandiguinn
Fière de mes origines, je suis née en France mais je ne suis jamais allée dans mon pays d’origine. Pour beaucoup, cela paraît impensable pour un descendant de parents immigrés de n’avoir jamais foulé la terre de ses ancêtres. Certes, je n’ai pas encore vu la Centrafrique, mais elle vit en moi. C’est donc entre rêverie et amertume que je pense à ce beau pays.
On m’a souvent reproché de ne pas être une “vraie” Centrafricaine représentative du pays, soit parce que je n’y suis jamais allée soit parce que je ne parle pas couramment le Sango, la langue nationale et officielle. Ceci m’amène souvent à m’interroger sur l’existence ou non d’une identité africaine : à partir de quel(s) moment(s) se sent-on appartenir à une identité ? existent-ils des caractéristiques spécifiques pour qualifier un individu et définir son identité ou sa nationalité ? J’aime bien la phrase de Kwamé Nkrumah qui dit que « Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l’Afrique est née en moi « . Pour moi, il m’est difficile de confronter mes deux identités car elles m’ont permis de me construire socialement ; il s’agit plutôt de faire une synthèse des deux pour former une “identité culturelle syncrétique”[1].
L’héritage culturel qui m’a été transmis repose sur l’histoire du pays que mes parents ont quitté dans les années 1970 et qui représente une immense richesse. La Centrafrique baigne en moi depuis mon enfance. En effet, c’est à travers des récits et des découvertes que j’ai pu m’immerger dans la culture de mon pays: j’ai été bercée par les cantiques en Sango de ma mère, l’histoire du pays par mon père ; j’ai inhalé les délicieux mets soigneusement mijotés (le ngoundja, le kôkô, les macaras, etc…) ; j’ai admiré les statuettes en bois et les tableaux en papillon qui ornaient les murs de mon salon ; j’ai chantonné le célèbre “Zô kwe zô” du chanteur Jude Bondeze ; et j’ai pris plaisir à badigeonner ma peau de beurre de karité importé du quartier de Boy Arabe.
Vers l’adolescence, je flânais dans les vieux albums photos qui montraient chaque recoins du pays allant de Bangui, autrefois “La coquette”[2], de Bambari à Kabo. Étrangement, je m’imaginais vivre chaque moment sur ces photos et avais cette drôle d’impression de connaître ces inconnus. Par ailleurs, regarder ces images, approfondissait ma peine car elle me rappelait que là-bas se trouve une grande partie de ma famille. Mon père a choisi de donner le nom de ma grande-mère “Nouba” ( qui veut dire “Dieu” en Ngama et en Nubien) pour préserver cet héritage culturel.
Implicitement, j’ai toujours préparé ma venue en Centrafrique, un peu comme une jeune étudiante avant un entretien d’embauche, en faisant de recherches sur l’histoire du pays, en m’intégrant dans les différents événements ou associations organisées par la diaspora ou encore en suivant l’actualité dans les médias. D’ailleurs, ma soif de découverte m’a ainsi poussé à orienter mes études dans le domaine du Développement et de la Solidarité Internationale. À vrai dire, les événements, qui ont plongé le pays dans le chaos déjà en 2012, m’ont profondément marqué et m’ont donné cette envie de participer au sursaut de mon pays. Comment rester impassible face aux nouvelles et aux images négatives, lamentables qui déshumanisent les siens ?
Cependant, en tant que membre de la diaspora, je suis consciente qu’il est impossible de contribuer au développement de mon pays sans être directement en contact avec la population sur place, pour mieux comprendre leurs mots et leurs maux. Ainsi, mon premier devoir est donc d’aller fouler le sol de ma terre, d’embrasser ma terre, le coeur profond du continent Afrique !
[1] Chouarra Laïla, Education, identité et réussité, L’éducation en débats: analyse comparée, Vol 2, Université de Lille 3, France.
[2] “Bangui La Coquette” est le surnom donné à la capitale dans les années 1960.

Kathleen Nandiguinn
Auteure